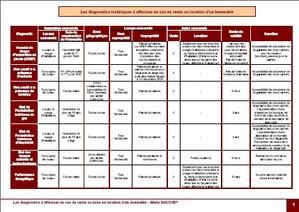L’article 27 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés avait habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la création d’un régime d’autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
C'est l'objet de l'ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009.
La législation relative aux ICPE régit les activités industrielles et agricoles, polluantes ou dangereuses, définies dans une nomenclature et classées sous le régime de la déclaration ou de l’autorisation selon la gravité des dangers ou inconvénients qu’elles présentent.
Ce régime d’autorisation simplifiée, dénommé enregistrement, constituera, dès la publication du décret d’application, un régime intermédiaire entre les régimes de déclaration et d’autorisation, d’ores et déjà prévus par la législation sur les ICPE.
Objectif et articulation avec les autres procédures d’instruction :
L’objectif de la réforme est d’alléger les procédures administratives relatives aux petites installations, dans les cas où il existe certes des risques significatifs justifiant un examen préalable du projet par l’inspection des ICPE (faisant de facto sortir ces installations du champ du régime déclaratif) mais qui peuvent être prévenus par le respect de prescriptions standardisées (et non par un examen lourd, tel que celui prévu dans le régime d’autorisation).
Les ICPE soumises à enregistrement bénéficieront ainsi de délais d’instruction plus court (de 4 à 5 mois encirons alors que ce délai était de plus d’un an pour les installations soumises à autorisation).
Afin d’éviter tout risque pour l’environnement, et conformément aux dispositions de la loi d’habilitation du 17 février 2009, l’ordonnance donne au représentant de l’Etat dans le département la possibilité de soumettre à la procédure d’instruction propre au régime d’autorisation une demande d’exploitation d’une installation relevant en principe du régime d’enregistrement, si l’instruction du dossier selon le régime simplifié laisse apparaître des risques particuliers ou cumulés.
En outre, le préfet pourra assortir l’enregistrement de prescriptions particulières venant compléter ou renforcer les prescriptions générales applicables à l’ICPE. Et, après la mise en service de l’installation, si les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ne sont pas protégés par l’exécution des prescriptions générales applicables à l’exploitation, le préfet pourra imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires.
Le contenu de l’ordonnance :
L’ordonnance prévoit :
- La création du régime d’enregistrement, les critères de classement des ICPE sous ce nouveau régime, les règles de procédure et la nature des prescriptions qui lui sont applicables ;
- La mise en cohérence ou l’adaptation des autres dispositions de la législation relative aux ICPE avec ce régime simplifié, afin d’assurer son intégration dans la législation existante ;
- Certaines dispositions de coordination d’autres législations existantes avec le nouveau régime (et notamment l’articulation avec la procédure de délivrance du permis de construire).
Ainsi, selon le nouvel article L. 512-7 du Code de l’environnement, sont soumises à enregistrement les installations présentant des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales.
Aux termes de l’article L. 512-7, les prescriptions générales pourront notamment prévoir :
- Des conditions d’intégration du projet dans son environnement local ;
- L’éloignement des installations des habitations, immeubles occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau ou zones destinées à l’habitation, par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ;
La procédure propre au régime d’enregistrement prévoit la constitution d’un dossier (mis à disposition du public), son instruction et la délivrance ou le refus d’un arrêté d’enregistrement.
Le demandeur doit avoir justifié que les conditions d’exploitation envisagées de l’ICPE garantissent le respect de l’ensemble des prescriptions applicables, et qu’il possède les capacités techniques et financières pour assurer tant l’exploitation de l’ICPE que la remise en état du site après son arrêt définitif (article L. 512-7-3 du Code de l’environnement).
En ce qui concerne la cessation d’activité, l’ordonnance reprend les dispositions applicables aux ICPE soumises à autorisation.
Entrée en vigueur :
L’entrée en vigueur du nouveau régime d’enregistrement est conditionnée à la publication d’un décret en Conseil d’Etat, qui devra notamment définir (i) le champ d’application du régime d’enregistrement et modifier en conséquence la nomenclature des ICPE, afin de faire basculer les installations concernées dans le champ de l’enregistrement et (ii) les prescriptions générales à respecter pour chaque catégorie d’installation.